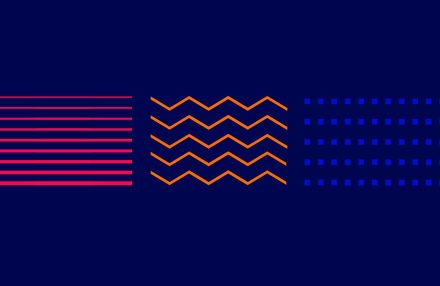Les ouvriers et les ouvrières de la scierie de Roberval sont en grève. Sous l’apparente cohésion de la lutte, on découvre rapidement les revendications plus personnelles de chacun. La folie s’empare des employé-e-s, qui rejoignent la ronde infernale du beau Querelle, héros de Jean Genet copié-collé dans ce décor québécois, élément de chaos, sable dans l’engrenage de la machine économique, hétérosexuelle et patriarcale.
Sur fond de désintégration sociale et d’exploitation ouvrière, Querelle de Roberval met en lumière un Québec peu visible en littérature et dans les arts en général. Oeuvre paru en 2018, il s’agit de votre second roman. Comment en êtes-vous arrivé à l’écrire ? Quel a été l’élément déclencheur ou le point de départ ?
Les premiers mots me sont venus d’une image : celle de grévistes sur une ligne de piquetage au bord d’une autoroute, en plein hiver. J’avais envie d’aborder l’héritage du syndicalisme révolutionnaire des années 1970, qui a été très actif et fort au Québec, de parler des possibilités et des difficultés de la révolte sociale aujourd’hui.
Quand j’étais au secondaire, l’autobus qui me menait à l’école passait tous les jours devant les travailleurs en grève de concessionnaires automobiles. À l’époque, je ne savais rien du monde du travail, de l’exploitation, de l’économie, des classes sociales, etc. Tout ce que je percevais, c’était une colère que les grévistes désiraient montrer publiquement. J’ai été marqué par cette colère que je ne comprenais pas, mais qui a rejoint une autre colère, plus informe, avec des objets plus fous, que j’avais en moi. En écrivant Querelle, j’ai cherché à comprendre ce qu’on ne m’avait jamais expliqué de manière satisfaisante à 13 ou à 14 ans.
Querelle de Roberval c’est l’histoire d’une révolte où s’entremêlent liberté sexuelle et lutte des classes. Y a-t-il une dimension plus importante que l’autre ? La fiction syndicale sert-elle de décor à la question du désir ?
La question du désir traverse les deux champs. Il s’agit de penser la politique comme une activité désirante, un désir de changement, de conditions de vie différentes, qui fonctionne de la même manière que le désir amoureux, avec ses scénarios, ses fantasmes, ses blessures, sa puissance aussi. Le désir gai me servait à déplacer la politique sur une autre scène, à lui faire prendre une autre courbure, plus privée, qui touche l’oppression sexuelle des minorités.
Certaines personnes n’ont pas accès à la même reconnaissance sociale que les autres pour des questions de désir. Le fait que leur désir soit rejeté, connoté comme abject par l’ordre dominant, accorde paradoxalement un potentiel révolutionnaire à ces désirs, qui peuvent attaquer, déplacer, contester les normes et les injonctions à être que nous imposent l’idéologie néolibérale, capitaliste. Cela ne se fait pas automatiquement, par défaut : c’est pourquoi il faut croiser les désirs, et entrer en lutte. Le personnage de Querelle, mais aussi celui de Jézabel ou des trois anges de la mort (le premier, le deuxième, le troisième) me permettent de le faire.
Vous revendiquez une filiation directe avec l’œuvre de Jean Genêt, notamment en ce qui concerne l’écriture de la langue et le travail de l’oralité. Quelles sont vos autres influences littéraires ou artistiques ?
Les Vernon Subutex de Virginie Despentes m’ont beaucoup appris sur les possibilités d’écrire le discours indirect libre, de se glisser dans la peau de personnages dont les visions du monde et les idéologies sont différentes, et parfois choquantes. J’admire beaucoup la sensibilité de Despentes, qui perçoit tous ces récits que l’on se construit pour justifier nos perceptions, nos lectures du monde et des événements. J’ai essayé de montrer cela dans Querelle, en abordant cette dimension qui précède à l’action, qui la motive ou la paralyse.
Je revenais toujours, pendant l’écriture du roman, à une sorte de trio un peu archaïque, presque originaire dans mon rapport à la littérature, dont je ne me défais en quelque sorte jamais et qui m’a beaucoup aidé pour travailler mes images (je leur en ai volé plusieurs) et le ton de certains passages : Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont.
Des romans qui parlent plus directement de grève ou de révolte ouvrière, comme Germinal d’Émile Zola ou La jungle d’Upton Sinclair ont aussi été absolument essentiels.
On a l’habitude de désigner les nouvelles générations d’artistes par le terme « relève ». Littéralement, on peut entendre ce mot comme une génération qui prend la relève d’une autre. Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous le fait d’être un artiste de la relève ? Vous considérez-vous comme tel ?
Je n’aime pas beaucoup cette idée, parce qu’elle suppose que la génération précédente quitte la scène, ou la « garde ». « Relève » est, comme « avant-garde », un terme d’origine militaire, qui a peu à voir avec la manière dont fonctionne la création. Je trouve qu’une conception dangereuse du temps travaille cette idée, comme si l’arrivée de jeunes artistes effaçait la présence de celles et ceux qui poursuivent une œuvre, qu’on sous-entend presque périmée, comme si le marché n’en avait que pour la jeunesse et la nouveauté, et ne savait pas interpréter la continuité et la poursuite. L’idée est particulièrement dangereuse pour les corpus minoritaires. Les œuvres des écrivain-e-s LGBTQ comme celles d’autres groupes minoritaires, sont plus dangereusement menacées par cette tendance qu’on a à oublier, à effacer. Les relais sont moins nombreux, les lecteurs et les lectrices aussi, et on a encore plus tendance que les autres à les catégoriser comme périmées, communautaires, mineures, etc. Il est important pour moi de comprendre que je n’apparais pas de nulle part, et que si je peux écrire aujourd’hui, c’est parce que d’autres l’ont fait avant moi, au Québec (Jean-Paul Daoust, Marie-Claire Blais, André Roy, Nicole Brossard, pour n’en nommer que quelques un-e-s) et ailleurs. Je ne veux pas prendre la « relève » de cette littérature parce que je refuse qu’elle quitte la scène, qu’on la renvoie à quelque passé dépassé.
Les notions de « nouveauté » et de « progrès » (on sait aujourd’hui, si on lit un peu de philosophie, comment ce concept est problématique, et comment ces idées se mettent aisément au service des logiques marchandes) appliquées aux arts sont extrêmement néfastes. Le temps de l’esthétique, la temporalité propre aux œuvres, ne connait pas, de toute manière, cette supposée marche téléologique vers un avenir qu’on suppose toujours plus « actuel ». J’ai l’impression qu’avec les arts, on tombe trop souvent soit dans une célébration un peu aveugle et amnésique de la « nouveauté », soit dans un conservatisme étouffant qui empêche l’entrée en scène de jeunes artistes ou d’approches dissonantes. Peut-être que ces deux stratégies, au fond, participent du même système, qui célèbre la nouveauté et la jeunesse tout en lui retirant tout pouvoir de contestation, en ignorant ce qu’elle veut dire. Il me semble que, hors de toute relève et hors de tout engourdissement sous le poids d’un passé monumental, ce qu’il faut, c’est comprendre la littérature dans son inactualité, dans sa non-contemporanéité, dans les temporalités multiples, contradictoires, qui la travaillent toujours. Pour ça, il faut lire les jeunes et il faut lire les vieux.
Quel regard portez-vous, en tant qu’artiste de la relève, sur ce moment exceptionnel d’interruption des activités due à la crise sanitaire ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer ?
Je crois qu’on devrait voir l’art et les artistes comme des choses extrêmement précieuses et fragiles. Si leurs conditions de vie ne sont pas assurées, et que leur travail n’est pas reconnu, des œuvres importantes, peut-être révolutionnaires, ne seront jamais créées. Il faut aussi savoir lire et reconnaître ces œuvres. Je rêve d’une formation esthétique plus grande et plus forte à l’école. Je regrette de n’avoir presque rien appris sur les arts et la littérature au secondaire.
Il y a encore trop peu de prix comme celui-ci, trop peu de possibilités de financement pour les artistes au Québec. On sait que les écrivains et les écrivaines sont parmi celles et ceux qui gagnent le moins d’argent avec leur travail.
La crise aujourd’hui nous montre, si on ne le voyait pas déjà, l’emprise qu’ont les grandes multinationales sur la culture québécoise. Amazon, Netflix, Spotify et les autres profitent du confinement général et ne payent toujours pas d’impôts à l’heure où l’on se parle. Les crimes qu’ils commettent aujourd’hui, on s’en rappellera comme de ceux des grandes compagnies étrangères qui ont longtemps exploité sans redevances le sol et les forêts québécois, sans aucune considération pour l’environnement, les populations locales, et avec la bénédiction de nos hommes et de nos femmes politiques.