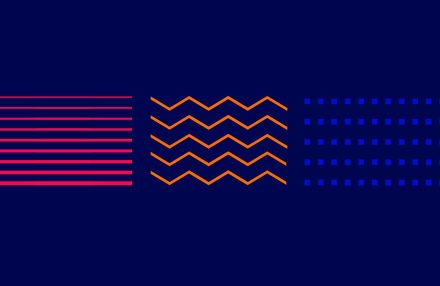Le recueil de poésie de Noémie Pomerleau-Cloutier s’inspire des centaines de rencontres que l’autrice a effectuées avec les personnes qui habitent au-delà de la route 138. On y retrouve des réflexions sur « nos façons d’habiter ainsi que ce qui nous habite ».
Nous avons l’habitude de désigner les nouvelles générations d’artistes par le terme « relève ». Littéralement, on peut entendre ce mot comme une génération qui prend la relève d’une autre. Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous le fait d’être une artiste de la relève ? Vous considérez-vous comme tel ?
J’ai encore de la difficulté à me considérer comme artiste à part entière, peut-être parce que j’ai plusieurs pans à ma vie. Peut-être que c’est aussi parce que j’ai un sentiment d’imposteure assez fort et que je doute constamment. Mais, pour répondre à la question, pour moi, être artiste de la relève, c’est avant tout être de cette génération d’artistes qui doivent beaucoup à tous.tes les autres qui nous ont tracé le sentier. C’est savoir qu’on leur est redevable, que l’on redonnera nous aussi, un jour quand une autre relève arrivera. C’est avancer avec les autres en tête, avec un esprit de communauté. Et je trouve ça beau : marcher sur les pas d’autres en gardant la voie vivante pour celles et ceux qui suivront.
Quel regard portez-vous, en tant qu’artiste de la relève, sur cette pandémie qui dure et ces moments d’interruption des activités causés par la crise sanitaire ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer ?
Je ne sais pas si je peux séparer ici l’artiste de la travailleuse du communautaire ou de l’humaine. Cette pandémie est extrêmement éprouvante pour toutes et tous, à plein d’égards et de multiples façons différentes, pour chacun.e d’entre nous. Je crois que la seule chose qui, moi, me permet de m’en sortir, est de me dire que derrière chaque comportement que les gens adoptent en moment se cache une multitude de difficultés et d’émotions. Et que ce sont ces émotions et ces difficultés qu’il faut accueillir, en leur laissant un espace pour être vécues. En tant qu’artiste, cela m’a donné l’idée de travailler sur l’accueil du deuil, dans un futur projet. Ça m’a aussi renforcée dans l’idée qu’il faut se tenir. J’espère que l’on apprendra, comme espèce, à mieux protéger ce qui nous entoure, ceux et celles qui nous entourent. Et qu’on se souviendra que c’est l’art qui nous a gardés hors des flots dans cette période difficile : les livres, les soirées virtuelles de poésie, la musique, le cinéma, le théâtre (même à la radio!), la télévision, les musées. J’espère finalement, qu’on aura compris que l’on est fragiles et que l’on aura plus de respect pour la vulnérabilité autour de nous.
Dans vos deux dernières œuvres, vous abordez le rapport avec la nature, le territoire et la Basse-Côte-Nord. À quel point la nature et ce territoire influencent-ils votre démarche artistique ?
En fait, mon premier livre, Brasser le varech parle du territoire de la Manicouagan, qui est en Côte-Nord, pas en Basse-Côte-Nord. Le deuxième livre, La patience du lichen, s’intéresse à la partie sans route de la Côte-Nord, de Kegaska à Blanc-Sablon, ce qu’on appelle la Basse-Côte-Nord. La région administrative et touristique de la Côte-Nord est immense, de Tadoussac à Blanc-Sablon d’est en ouest et de Tadoussac à Schefferville et Fermont du sud au Nord. C’est de multiples territoires dans un grand territoire.
J’ai grandi en Afrique, en Gaspésie et dans la Manicouagan, sur la Côte-Nord. Je suis convaincue que l’endroit où l’on grandit nous influence tous et toutes, pas que les artistes. Et je crois que l’on peut aussi subir l’influence d’un territoire qu’on choisit d’habiter par la suite. Je considère que l’on devrait, en quelque sorte, pouvoir être en mesure de déterminer ses origines et de choisir les influences qu’on conserve des endroits que l’on habite / qui nous habitent.
Je suis clairement influencée par l’eau. Je suis une personne que l’eau calme, nourrit, berce, nettoie. D’ailleurs, on oublie souvent que Montréal est une île, que l’on est entouré.e.s d’eau. J’explore depuis quelques années l’insularité de Montréal. Je vais dans plusieurs coins de l’île voir le fleuve et ses affluents. Et ça me fait un grand bien.
J’ai aussi besoin du mouvement dans la vie. Je suis vraisemblablement influencée par les marées et les longs kilomètres de route. Je suis bien quand je suis en déplacement, quel qu’il soit. Plusieurs de mes idées me viennent d’ailleurs en marchant en ville ou en cueillant, dans les forêts ou sur la plage quand j’ai la chance de quitter la métropole pour aller sur la Côte-Nord.
Je suis aussi influencée par la force d’attachement au territoire qu’ont les gens en Côte-Nord et en Basse-Côte-Nord. J’ai beaucoup bougé dans ma vie, habité différents endroits, même différents pays. Cet enracinement me fascine, moi qui vis l’exil depuis toujours. Je suis également fascinée par le reflet du territoire dans nos comportements. Je vois vraiment le territoire dans les êtres qui l’habitent. C’est une relation fragile et complexe. Le territoire ne nous appartient pas, nous lui empruntons des bouts de lui-même, nous l’arpentons un moment. Et c’est ce que j’ai voulu transmettre dans La patience du lichen, cette vulnérabilité et cette force du lien.
La structure « géographique » de votre recueil où chacun des chapitres est un « village » est très intéressante. Est-ce que cette structure s’est imposée rapidement lors de l’écriture ?
Comme j’ai voulu présenter un peu de toutes les communautés de la Basse-Côte-Nord, le faire en y allant un chapitre par village (même pour le village disparu d’Aylmer Sound, encore bien présent dans les mémoires) me paraissait tout indiqué. Ce qui m’est apparu le plus rapidement, c’est le titre, dès le début du projet, il s’est imposé. Il m’aurait été très difficile de le changer, d’ailleurs. 😉 Ensuite, je savais que j’aurais un premier chapitre qui décrirait la région en gros, le chapitre ICI, puis un chapitre sur la route à finir, pour terminer le livre. Le poème du début et le poème de la fin ont d’ailleurs été dans les premiers que j’ai écrits. Dès le premier séjour, j’ai su que je voudrais revenir en Basse-Côte-Nord, autant de fois qu’il le serait nécessaire, toujours. Je crois bien honnêtement que cette région ne me quittera plus jamais.
Dans le processus de création de La patience du lichen, il y a eu des nombreuses rencontres, des enregistrements avec les Coasters. Avec cette œuvre, vous permettez aux populations de la Basse-Côte-Nord de se faire entendre, d’amplifier leurs voix. Qu’est-ce qui vous a marqué le plus dans ce processus, dans cette démarche ?
La générosité et la confiance des gens. Cela peut paraître cliché, mais c’est littéralement ce qui a été le plus époustouflant dans ce projet. On m’a accueillie, hébergée, nourrie, transportée, soignée et surtout parlé. On m’a raconté des choses très intimes pendant de longs moments alors qu’on ne me connaissait pas du tout, avec confiance. Ça prend une sacrée générosité pour faire ça. Rien n’égalera jamais cette confiance que j’ai reçue. C’est pour cette raison que je donne mes droits d’autrice aux jeunes de cette région. C’est aussi pour cela que dès qu’une personne de la Basse-Côte-Nord voudra être publiée, je m’efforcerai de l’aider du mieux que je peux, soit en la conseillant, soit en la référant à un.e écrivain.e en qui j’ai confiance.
Pour répondre à la confiance de toutes mes forces, j’ai fait ce projet avec le plus grand respect possible et je continue de soigner mes relations avec les gens rencontrés. Je crois qu’on oublie trop souvent l’après-écriture, surtout quand on traite de la vie des autres. Il faut prendre soin des liens qu’on a créés. C’est une question d’éthique et de respect.