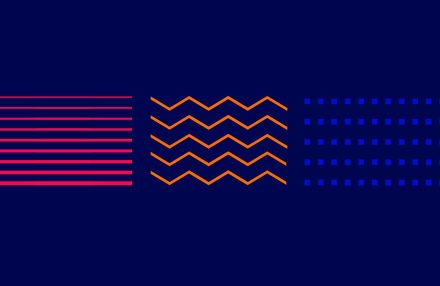En écrivant La femme cent couleurs, son premier recueil, Lorrie Jean-Louis inscrit sa condition de femme noire dans la poésie contemporaine du Québec, interrogeant l’exclusion, le refus de reconnaissance, le racisme et la peur.
La femme cent couleurs est un recueil de poésie né « d’un questionnement et d’une colère » ? Pouvez-vous nous en dire plus sur les éléments déclencheurs de l’écriture de ce recueil ?
On prête souvent la colère aux personnes noires comme si on savait pleurer à la place des autres. À chaque fois, j’en suis stupéfaite. La colère est un sentiment simple et éphémère. Ce n’est pas un sentiment qui correspond à une injustice et une violence plusieurs fois centenaires qu’est la race et le racisme. La tristesse serait plus juste, même si ce n’est pas assez juste.
J’ai deux maîtrises : une en littérature et une en bibliothéconomie. Après deux ans de recherche d’un emploi alors que je n’en occupais aucun, je me suis mise à désirer créer un réservoir de dialogue. M’inquiétant pour moi-même, je cherchais un moyen de ne pas sombrer dans le désespoir.
J’ai donc convoqué les femmes à qui je dédie ce recueil et j’ai cherché à les connaître. J’ai pensé que pour que je sois vivante, beaucoup de femmes avant moi avaient souffert énormément, mais, elles avaient survécu. Je leur ai demandé de l’aide pour voir ce que, seule, je ne verrais pas. Le dialogue a été fructueux. Le recueil existe.
Où en serais-je avec la colère ? On écrit un ou deux poèmes sous la colère, mais pas La femme cent couleurs.
Comment définiriez-vous le projet littéraire de La femme cent couleurs ? Est-ce une tentative de réappropriation identitaire et une quête de la beauté qui s’expriment à travers la langue poétique ?
Si un lecteur ou une lectrice traverse ce recueil, il/elle verra que La femme cent couleurs est un personnage complètement anarchique. Elle n’a jamais conçu de « projet littéraire », non pas parce que c’est trop ambitieux ou trop cadré, mais simplement parce qu’elle n’obéit qu’à ses propres lois et elles sont imprévisibles. Elle n’essayait pas de se réapproprier quoi que ce soit, rien, sinon, sa douce folie. Rien ne lui a jamais appartenu. Pour la beauté, c’est ainsi qu’elle conjugue le présent pour le traverser. Elle sublime.
Hannah Arendt, que vous lisez et aimez, envisageait l’humanité comme une communauté des exceptions. Souscrivez-vous à cette vision du monde qui repose sur un équilibre entre une identité personnelle qui dit « je » et une identité collective qui dit « nous » ? Plus particulièrement, quelle lecture faites-vous de la conception du « nous » québécois ?
Une chose qu’Arendt a dite qui me marque c’est que notre humanité se déploie dans la continuité de la chaîne humaine. J’essaie de m’y plier et de poser des gestes qui consolident cette chaîne.
Pour vivre en territoire non cédé quand on n’est pas du côté des conquérants, je mise sur les relations de un à un. Les mythologies ambiantes me bousculent ; je ne peux pas prétendre en faire partie sans m’aliéner.
Aussi, comme je lutte contre le racisme systémique et que l’identité nationale, quelle qu’elle soit, a des parallèles avec ce trope qu’est l’identité nationale, incluant et qui excluant selon des critères assez flous, je ne peux pas entrer là.
Quand je dis « nous », je parle des gens qui sont physiquement avec moi autour d’un repas ou d’une idée.
On a l’habitude de désigner les nouvelles générations d’artistes par le terme « relève ». Littéralement, on peut entendre ce mot comme une génération qui prend la relève d’une autre. Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous le fait d’être un artiste de la relève ? Vous considérez-vous comme tel ?
Selon moi, l’artiste est quelqu’un qui sait faire œuvre de sa sensibilité. Oui, je me reconnais comme artiste de la relève dans la mesure où ma sensibilité est mise à la lumière du jour. C’est d’autant plus important de me reconnaître comme relève alors que je n’ai pas la mémoire d’une poète née en sol québécois d’origine caribéenne.
Quel regard portez-vous, en tant qu’artiste de la relève, sur ce moment exceptionnel d’interruption des activités due à la crise sanitaire ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer ?
Avant d’écrire La femme cent couleurs, j’écrivais. J’ai toujours écrit clandestinement, donc pas dans le confort. Je dirais qu’en tant qu’artiste de la relève, j’aimerais que les gens apprennent, avec leurs moyens, à fabriquer de l’espoir. Disons que cet espoir ne peut advenir si l’espace intérieur en chacun n’a pas été travaillé, enrichi, aimé. Il faut beaucoup d’imagination. Comme la situation n’est pas finie, je ne peux pas déjà vouloir en tirer des leçons. Il faudra du temps et de la distance pour en arriver aux leçons.